09 septembre 2021#15
Les fleuves sont-ils des personnes ?
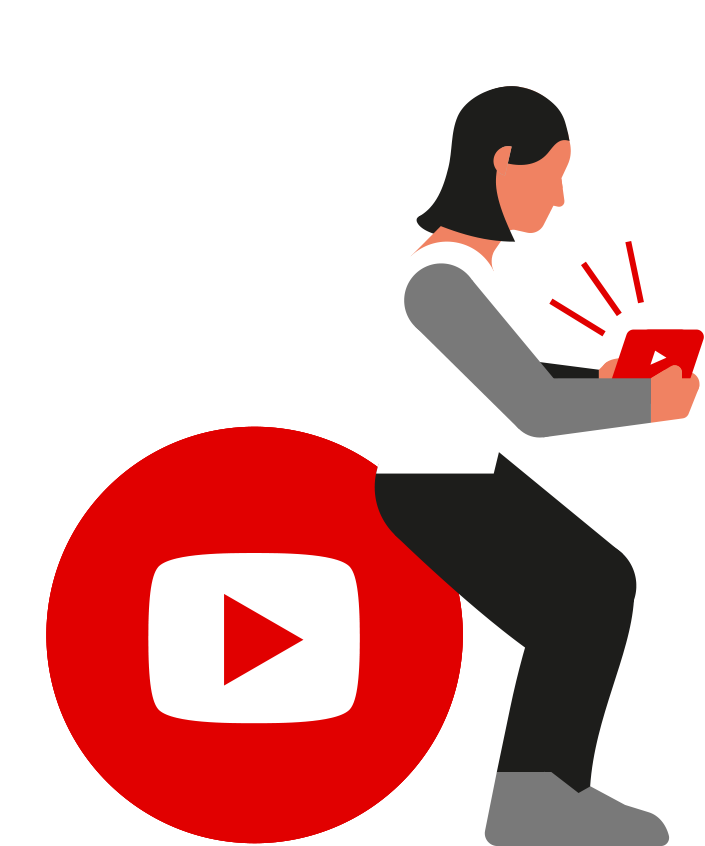


Les fleuves ont-ils des droits, comme vous et moi ? Peuvent-ils saisir la justice pour se défendre contre les pollueurs ? Les rivières sont-elles des personnes ? Si ces questions vous surprennent, sachez que le Parlement néo-zélandais a accordé la personnalité juridique à un cours d’eau, le Whanganui. Tout récemment, c’est la rivière Magpie du Québec qui s’est vu octroyer neuf droits… dont celui de couler. Et dans le flot des parutions de la rentrée, L’AntiÉditorial a péché Le fleuve qui voulait écrire, un livre qui veut faire avancer les droits de la Loire. Qu’est-ce que cela veut dire ? Pourquoi ce combat ?
Remontons à la source
D’abord, c’est une histoire ancienne. Revenons à la source.
Première étape : la mythologie. Chez les Grecs, les fleuves abritent des divinités, les potamoi. Le dieu du fleuve Alphée est le fils d’Océan et de Téthys. Toutefois, on ne peut pas dire que ses droits aient été très respectés. Hercule l’a carrément détourné pour nettoyer les écuries d’Augias !
Deuxième étape : la théologie. Une chercheuse française, Sarah Vanuxem, rappelle qu’un intellectuel du XIIe siècle, Moïse de Bergame, archevêque de Ravenne, proposait que les entités naturelles, des terres ou des églises, puissent posséder des biens meubles ou immeubles, inaliénables aux hommes. Ce n’est plus un couvent qui possède des terres et peut les céder, ce sont des terres qui possèdent un couvent, et personne ne peut se les approprier.
Troisième étape : la philosophie. En 1971, un professeur de philosophie du droit, Christopher Stone, a le premier posé la question. Pourquoi les entreprises seraient-elles dotées de la personnalité juridique, et pas les rivières, les montagnes, les forêts ou les sites naturels ? Total, Danone ou Auchan ne peuvent pas aller en personne devant les tribunaux. Il faut bien qu’un avocat humain les représente. Alors pourquoi pas le Rhin, le Rhône ou l’Amazone ?
Après tout, nous vivons de fictions juridiques. L’État, par exemple, ou l’Union européenne, ou les partis politiques, ou même la souveraineté populaire… Même la notion de personne humaine est une construction qui a évolué : les Romains considéraient les esclaves comme des choses.
Ces constructions ont du sens et elles produisent des effets concrets. Alors, oui, pourquoi les grands fleuves, les mers ou les espaces naturels ne seraient-ils pas reconnus et représentés comme des personnes morales d’un nouveau genre ?
Droits des fleuves ou des peuples ?
En 2017, la Nouvelle-Zélande a reconnu le Whanganui comme entité vivante. Mais en 2008, c’est l’Équateur qui fut le premier État à inscrire dans sa Constitution les droits de la nature, ou « Pacha Mama ».
Et puis, il y a la rivière Magpie, au Canada. Muteshekau-shipu en langue innue – « la rivière aux rives abruptes et aux rochers pointus ». On vient de lui reconnaître neuf droits. Certains sont assez poétiques, comme le droit « de vivre, d’exister et de couler » ou le droit au « respect de ses cycles naturels ». D’autres plus prosaïques, comme le droit d’être préservé de la pollution et celui d’aller en justice.
Équateur, Canada, Nouvelle-Zélande… On le voit, le progrès du droit des fleuves est inséparable du combat des peuples premiers. Le texte québécois qui octroie ces neuf droits à la rivière Magpie est d’ailleurs rédigé par une instance indigène, le conseil des Indiens innus. « La reconnaissance des droits de la nature assure le respect du droit à l’autodétermination et aux droits bioculturels de la première nation innue. » Voilà ce que dit le document.
Notons au passage le paradoxe. Cette notion de « personnalité juridique », nous l’avons héritée du droit romain. Elle est complètement étrangère aux peuples premiers. Et ces mêmes peuples sont à la pointe du combat pour imposer dans le droit, notre droit, une nouvelle catégorie de personnes, au sens juridique du terme.
Séparer ou relier ?
L’anthropologue Philippe Descola l’a montré : la distinction entre objets et sujets n’existe pas chez les peuples amazoniens. Mais pour nous, Occidentaux, penser, c’est distinguer. D’un côté la culture, de l’autre la nature. D’un côté « le monde sauvage », et de l’autre le monde cultivé, voire exploité. D’un côté les personnes, de l’autre les choses. Dans Le fleuve qui voulait écrire, une philosophe de l’environnement, Catherine Larrère, rappelle que « dans nos sociétés techniques, depuis la fin du XVIe siècle, nous séparons. Nous entretenons un rapport dualiste au monde. La nature d’un côté, la société humaine de l’autre. Nous vivons dans ce partage. Et c’est pour cette raison que nous avons tendance à penser que la nature est plus naturelle quand il n’y a pas d’humains. »
Du coup, la préservation de l’environnement a longtemps conçu la nature comme une forteresse, un monde à part. C’est la logique des Parcs nationaux. Mais cette logique montre ses limites alors que les espaces sauvages se réduisent. Prenez le Vjosa d’Albanie, qui sert d’habitat à l’anguille d’Europe, anguilla anguilla, une espèce en danger critique d’extinction. On dit que c’est le dernier fleuve d’Europe dont le cours demeure naturel. Et cela pourrait ne pas durer puisque des projets hydroélectriques le menacent.
D’où la nécessité de changer de paradigme. Et d’où l’émergence de ce que Marie-Angèle Hermitte, une chercheuse de l’Ehess (l’École des hautes études en sciences sociales), n’hésite pas à appeler « l’animisme juridique », quitte à chatouiller notre sensibilité. Certains militants proposent même une solution encore plus radicale. Ils veulent revoir la hiérarchie des normes : au sommet, les droits de la nature, puis les droits de l’homme, et tout en bas, le droit des sociétés.

Qu’est-ce que ça change ?
Considérer qu’un fleuve est une personne, est-ce symbolique, ou est-ce que cela produit vraiment des effets ? Selon le ministre de la Justice de Nouvelle-Zélande, le Whanganui reçoit bel et bien « la personnalité juridique, avec tous les droits et les devoirs attenants ». Si une rivière déborde, comme en Allemagne tout récemment, pourra-t-on lui faire un procès pour qu’elle répare les dégâts qu’elle a commis dans les villages ?
En réalité, l’effet est politique et symbolique avant d’être juridique. Dans le cas du Whanganui, le Parlement néo-zélandais reconnaît le lien spirituel entre une tribu maorie et son cours d’eau. Certes, ça ne règle pas tous les problèmes. Une compagnie hydroélectrique continue d’utiliser 80 % de l’eau du Whanganui et sa concession ne se terminera pas avant 2039.
En Équateur, si le rio Vilcabamba a bel et bien fait condamner une société de construction qui l’avait pollué, le jugement n’a jamais été exécuté. Mais le même rio Vilcabamba a pu faire stopper un projet de route. Bref, les résultats concrets sont mitigés.
L’effet long cours
Mais il faut ajouter un point capital, qui permet paradoxalement de défendre les intérêts à long terme de l’humanité. Comme le souligne Reporterre : « Le contentieux écologique est souvent fondé sur le droit humain à un environnement sain et le droit de propriété. Ceci limite le champ d’action aux dommages subis par un être humain. Accorder la personnalité juridique à une entité naturelle permet aux citoyens de saisir la justice au nom de l’entité, en raison des dommages subis par celle-ci directement. » C’est ce qu’on appelle le « préjudice écologique pur ». La loi (ou la jurisprudence) reconnaît les intérêts d’un écosystème, d’un milieu naturel, ou d’espèces animales, que des communautés ou des personnes aient subi un dommage ou pas. Cette notion capitale de préjudice écologique pur a commencé à s’imposer chez nous en 2016, grâce à la Cour de cassation, à travers le procès de l’Erika.
En Équateur, n’importe qui peut aller en justice au nom d’une entité naturelle. Et il n’y a pas besoin de prouver que des intérêts humains subissent un préjudice, par exemple, car l’eau que l’on boit est polluée. L’article 71 de la Constitution le dit clairement : « Toute personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature. »
Et chez nous ?
Mais l’expression des droits, ce n’est pas seulement la justice, c’est aussi la délibération, la démocratie. En 2019, un colloque pas comme les autres a voulu imaginer « les formes et fonctionnements d’un parlement pour une entité non-humaine (la Loire), où la faune, la flore et les différents composants matériels et immatériels seraient représentés. » C’est cet événement que l’écrivain Camille de Toledo a suivi et repris, et qui donne aujourd’hui naissance à ce livre, Le fleuve qui voulait écrire, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Un travail exigeant, foisonnant, captivant, où l’on croise les meilleurs penseurs du moment. Comme Bruno Latour ou Valérie Cabanes, qui militent avec d’autres pour la reconnaissance du « crime d’écocide » dans le droit international.
Au-delà du cas de la Loire, le chemin semble encore long. Prenez par exemple cette phrase : « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique. » Le gouvernement français a renoncé à l’inscrire dans la Constitution, alors que c’était la principale proposition de la Convention citoyenne sur le climat. Et ceci a donné lieu à toute une controverse.
Certes, la Charte de l’environnement de 2005 a valeur constitutionnelle. Elle stipule notamment que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Mais encore une fois, les droits de la nature sont définis par rapport à ceux des hommes, en l’occurrence ceux de la Nation.
On le voit, le droit des fleuves reste une affaire au long cours. Mais après tout, les petits ruisseaux militants feront peut-être les grandes rivières politiques.


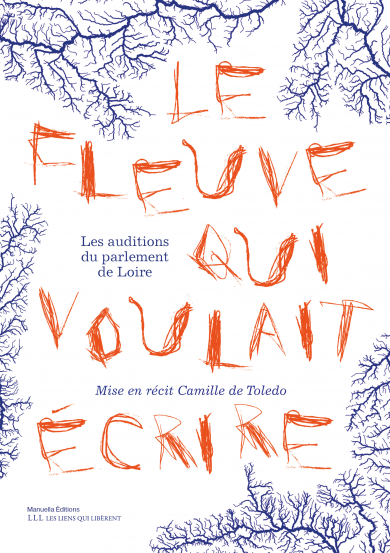
De Toledo, Camille. (2021). Le fleuve qui voulait écrire. Les Liens qui libèrent.

Article publié dans le journal La Croix (2017)

Article publié sur le site Reporterre (2019)




