06 mai 2021#3
Vite, résistons à l’autocensure !
Bonjour,
et d’abord merci pour la qualité de vos échanges depuis le lancement de ce média. Pour ce numéro, L’AntiÉditorial vous emmène de l’autre côté de l’Atlantique, là où de nombreuses voix s’élèvent contre l’autocensure… Bon voyage !
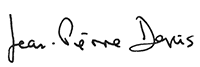
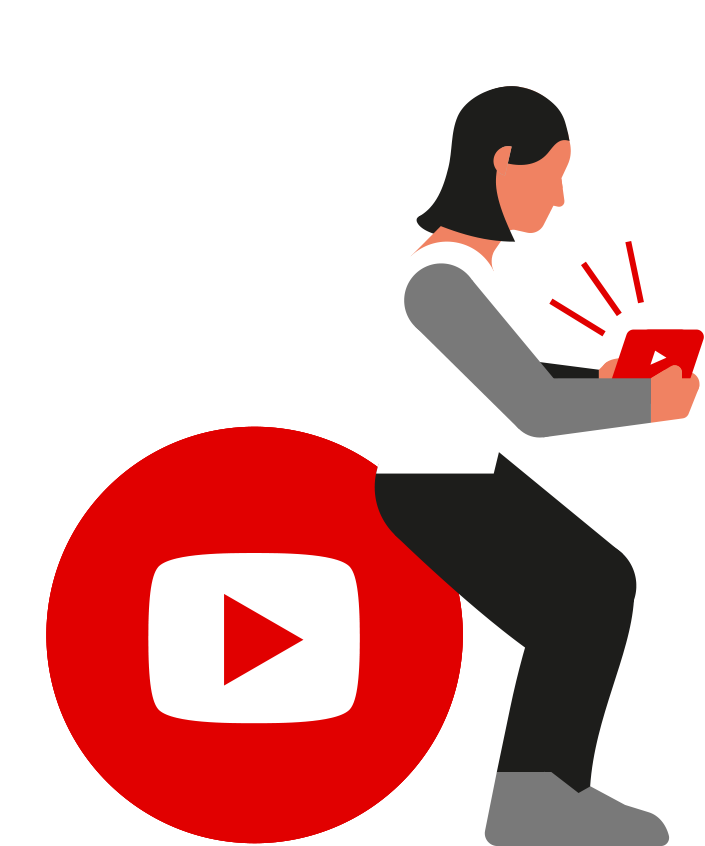


« On ne peut plus rien dire ! » Cette phrase, lequel ou laquelle d’entre nous ne l’a pas prononcée un jour ou l’autre, ou entendue au hasard d’une émission ? Parfois, c’est vrai, elle vient après une mauvaise blague, une réflexion douteuse, un peu sexiste, un peu raciste. Ou alors, nous avions dit quelque chose qui nous semblait anodin, et soudain l’autre réagit de façon agressive. Il estime sa sensibilité blessée ou son identité menacée.
Mais ce qui pouvait passer pour une manifestation de mauvaise humeur, un trait de mauvaise foi ou l’expression d’une inquiétude superficielle est en train de devenir, aux yeux de beaucoup, un sujet de préoccupation absolument majeur. Disons-le tout net : on ne plaisante plus avec l’humour. On ne peut plus rire de rien, et on ne plus rien dire. Car il n’y a pas que l’humour, il y a les idées. Toutes les idées. Et partout : à l’université, dans les médias, sur les réseaux sociaux… Dans les grandes démocraties, la liberté d’expression se trouve de plus en plus attaquée.
Beaucoup d’intellectuels, d’artistes ou de journalistes s’inquiètent. Certains s’autocensurent. D’autres se voient privés de parole. C’est ce que l’on appelle la cancel culture, la culture de l’annulation, quand on veut faire disparaître quelqu’un du paysage. Soit parce qu’il a commis une faute, un harcèlement sexuel par exemple. Soit parce qu’il dit des choses ou créé des œuvres que certains peuvent juger choquantes, alors qu’elles relèvent normalement de la simple opinion ou de la liberté artistique. Mais le phénomène commence à susciter un certain ras-le-bol. Aux États-Unis, une véritable résistance a vu le jour. Depuis quelques temps, elle se structure. Et aujourd’hui, elle contre-attaque. Alors, puisqu’en ce moment il nous est difficile de voyager, L’AntiÉditorial vous propose de traverser l’Atlantique…
L’affaire Bari Weiss
En novembre 2020, dans un entretien passionnant et passionné au Point, la journaliste Bari Weiss expliquait pourquoi elle avait décidé de quitter le New York Times et ses pages opinion, où il lui était devenu impossible de proposer des sujets originaux. Selon elle, dans les médias d’aujourd’hui, la frontière n’est pas idéologique mais professionnelle. Elle n’est pas tracée entre les progressistes et les conservateurs. « Elle sépare ceux qui rendent compte des faits, y compris quand la vérité est dérangeante, et ceux qui croient à ce que l’on appelle la ”clarté morale”, et donc promeuvent une certaine vision du monde. Dans un milieu comme celui du New York Times, la curiosité semble être à sens unique. »
Les explications sont multiples. D’abord, estime-t-elle, la politique a remplacé la religion dans « le désir zélé de purger le monde des hérétiques ». Mais pour Bari Weiss, c’est aussi et peut-être surtout le modèle économique actuel de la presse qui est en cause, et pas seulement l’idéologie ambiante. Car, relève-t-elle justement, « il conduit à offrir au consommateur ce qu’il réclame. Dans l’ancien modèle, on avait peur de fâcher les annonceurs ; dans celui d’aujourd’hui, on a peur de fâcher son public. La très grande majorité des lecteurs du New York Times s’identifient comme progressistes ou démocrates. Chaque editor, voulant que ses articles soient lus, sait qu’en flattant les lecteurs et la foule des internautes, il aura du succès.
Tout récit ou point de vue qui va à l’encontre du discours attendu rend la démarche du journaliste beaucoup plus risquée : il doit être sûr de lui et de son sujet, et se convaincre que cela en vaut la peine. S’il veut garder son poste, qu’il a un crédit immobilier et des enfants, il ne se lancera pas dans ce projet. Et, comme les règles changent vite, il s’autocensure non seulement pour le présent, mais aussi pour l’avenir. Il anticipe : mes propos me causeront-ils des problèmes dans cinq semaines, dans cinq ans ? Il n’existe pas encore de modèle économique vertueux pour inciter les journalistes à préférer le compte-rendu honnête à la dépendance vis-à-vis du public. »
Plus on sait, plus on se tait
Deux intellectuels américains, James L. Gibson et Joseph L. Sutherland, ont écrit un article remarquable sur la montée de l’autocensure. Ils apportent deux informations étonnantes, et tout à fait contre-intuitives. La peur de parler, prouvent-ils, est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’à l’époque du maccarthysme. Oui, en pleine campagne de chasse aux sorcières communistes, on avait moins peur qu’aujourd’hui ! « Dans les années 1950, de nombreux spécialistes des sciences sociales se sont inquiétés du fait que les efforts déployés pour éradiquer les gauchistes créaient une ”génération silencieuse” d’Américains qui avaient peur de partager leurs opinions politiques en public », rappellent-ils. Or, à l’époque, seul un Américain sur huit avait peur de dire ce qu’il pensait.
Mais au fil du temps, les réponses des sondés sont devenues beaucoup plus inquiétantes. « À son point culminant en 2015, près de la moitié des Américains ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas libres d’exprimer leurs opinions. » Conclusion des deux auteurs : « Cette tendance est inquiétante à première vue. Par rapport à l’ère McCarthy, elle est effroyable. La réponse à la question qui fait aujourd’hui l’objet d’un si large débat semble sans ambiguïté : les Américains sont beaucoup plus susceptibles de s’autocensurer aujourd’hui que par le passé. »
Les auteurs observent que la peur de dire ce qu’on pense est aussi forte chez les sympathisants démocrates que chez les sympathisants républicains : 39 % dans un cas, 40 % dans l’autre. Elle est aussi la même chez les gens modérés que chez ceux qui ont des opinions extrémistes. En revanche, et c’est le deuxième grand enseignement de l’étude, « les Américains sont d’autant plus susceptibles de s’autocensurer qu’ils sont urbains et instruits. Dans un renversement surprenant des tendances habituelles de la participation politique, selon lesquelles les citoyens qui ont plus de ressources se sentent plus à même de jouer un rôle actif dans la vie civique, ce sont les citadins et les personnes très instruites qui ont le plus peur de dire ce qu’ils pensent. »
Parmi les Américains sans diplôme d’études secondaires, par exemple, 27 % disent qu’ils s’autocensurent. Parmi ceux qui ont fréquenté l’université pendant au moins quelques années, 45 % le feraient. D’où cette affirmation terrible des deux auteurs : « Cela suggère que les Américains sont socialisés pour apprendre à se taire : plus vous passez de temps dans le système éducatif, plus vous apprenez qu’il est approprié d’exprimer certaines opinions, mais pas d’autres. Les Américains peu instruits et vivant dans l’arrière-pays se sentent en fait plus libres de dire ce qu’ils pensent. Peut-être n’ont-ils tout simplement jamais appris qu’il était sage de se taire. »

L’autre pandémie
Dans un long article, brillant mais très alarmiste, Bari Weiss fait le même constat : « une épidémie d’autocensure menace la démocratie. Mes amis libéraux qui vivent dans l’Amérique républicaine avouent éviter les discussions sur les élections de 2020 et Donald Trump. »
« Mais il y a deux cultures illibérales qui engloutissent le pays. Dans mon Amérique, les gens qui se taisent ne craignent pas la colère des supporters de Trump. Ils craignent la gauche illibérale. Ce sont des féministes qui croient qu’il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Des journalistes qui croient que leur travail consiste à dire la vérité sur le monde, même quand cela dérange. Des médecins dont le seul credo est la science. Des avocats qui ne transigeront pas sur le principe de l’égalité de traitement devant la loi. Des professeurs qui recherchent la liberté d’écrire et de faire des recherches sans craindre d’être dénigrés. En bref, ce sont des centristes, des libertaires, des libéraux et des progressistes qui ne souscrivent pas à tous les aspects de la nouvelle orthodoxie d’extrême-gauche. »
Bari Weiss affirme qu’après avoir démissionné du New York Times, elle a reçu presque tous les jours des témoignages en ce sens. Ils lui font penser, confie-t-elle, « à des missives sorties clandestinement d’une société totalitaire. » Elle cite ce mail reçu d’un étudiant de l’une des meilleures facultés de droit du pays, depuis son courriel personnel, car il dit craindre de l’envoyer depuis son compte officiel à l’école : « L’autocensure est la norme, pas l’exception. Je m’autocensure même lorsque je parle à certains de mes meilleurs amis, de peur que les mots ne circulent. »
Certes, rappelle Bari Weiss, « nous vivons dans la société la plus libre de l’histoire du monde. Il n’y a pas de goulag ici, comme c’était le cas en Union soviétique. Il n’y a pas de système de crédit social officiel, comme c’est le cas aujourd’hui en Chine. Et pourtant, les mots que nous associons aux sociétés fermées – dissidents, doubles penseurs, listes noires – sont exactement ceux qui (lui) viennent à l’esprit » lorsqu’elle lit les messages qu’elle reçoit.
En bref, « la vision libérale du monde que nous tenions pour acquise en Occident depuis la fin de la guerre froide jusqu’à il y a quelques années seulement est assiégée. Elle est assiégée à droite par la propagation rapide des cultes et des théories du complot sur Internet. » Et « à gauche, le libéralisme est assiégé par une nouvelle orthodoxie illibérale qui a pris racine un peu partout, y compris dans les institutions censées défendre l’ordre libéral. Et l’annulation est l’arme la plus efficace de cette idéologie. » C’est ce que l’on appelle, en effet, la cancel culture.
Bari Weiss évoque aussi le biologiste Bret Weinstein qui se définit comme « professeur en exil » après avoir quitté son université d’Evergreen dans des conditions hallucinantes, après avoir été accusé injustement de racisme, empêché d’enseigner et lâché par les responsables du campus et ses collègues. Pour Bret Weinstein, l’Amérique est désormais composée de quatre groupes sociaux : « les quelques personnes qui chassent réellement les sorcières, un grand groupe qui suit le mouvement et un plus grand groupe qui reste silencieux. Il y a aussi un petit groupe qui s’oppose à la chasse. Et ce dernier groupe devient des sorcières »
Obama intervient
Même Barack Obama s’en inquiète, et il en a parlé en septembre 2015 lors d’une rencontre avec des lycéens à Des Moines, dans l’Iowa : « J’ai entendu parler de certains campus universitaires où ils ne veulent pas avoir un conférencier invité qui, vous savez, est trop conservateur. Ou ils ne veulent pas lire un livre dont le langage est offensant pour les Afro-Américains, ou qui, d’une manière ou d’une autre, envoie un signal dégradant envers les femmes. Je dois vous dire que je ne suis pas d’accord avec ça. Je ne suis pas d’accord avec le fait que, lorsque vous devenez étudiants dans les universités, vous devez être dorlotés et protégés des différents points de vue. »
Cela me fait penser à ce qu’avait dit Frederick Douglass dans son célèbre discours de Boston le 9 décembre 1860 : « Aucun droit n’a été jugé plus sacré par les Pères du gouvernement que le droit de parole, le grand rénovateur moral de la société et du gouvernement. Lorsque le droit d’exprimer ses pensées et ses opinions a cessé d’exister, la liberté n’a plus aucun sens. Ce droit, parmi tous les droits, est la hantise des tyrans. C’est le droit qu’ils sont les premiers à abattre. » Frederick Douglass, rappelons-le, est un ancien esclave, devenu l’une des grandes voix de l’abolitionnisme et de la lutte pour l’égalité des droits au XIXe siècle.
La résistance s’organise
Alors, évidemment, comme c’est l’Amérique, la contre-offensive s’organise, y compris en cherchant un modèle économique. Et il faut dire que le numérique, s’il pousse à l’autocensure, aide aussi à ouvrir des espaces, ce qui permet d’ailleurs à certains d’affirmer que l’autocensure est un mythe. Le biologiste Bret Weinstein, par exemple, a plus de 450 000 abonnés sur Twitter. Le journaliste Dave Rubin, qui en a près d’un million, a créé un média indépendant, The Rubin Report, qui est aussi un réseau social. L’historien des idées Mark Lilla a eu pas mal d’écho en France grâce à la traduction de son essai La Gauche identitaire – l’Amérique en miettes, en 2018, chez Stock.
On pourrait aussi citer l’écrivain métis Thomas Chatterton Williams, qui milite pour une société post-raciale. Et puis il faut évoquer la création de nouvelles publications ou de newsletters. Yascha Mounk, l’auteur très remarqué d’un essai traduit en France sous le titre Le Peuple contre la démocratie, vient de lancer Persuasion, une plate-forme qui veut résister à la tendance illibérale et populiste qui mine la démocratie. Elle est destinée à ceux qui « sont disposés à changer d’avis, mais pas à abandonner leurs valeurs fondamentales », parmi lesquelles un attachement à la liberté de pensée. On dirait presque la définition de L’AntiÉditorial en version américaine !
Voilà pour les individus. Mais il y a aussi les ONG, les associations, les plate-formes. Depuis quelques années, les collectifs se multiplient en réaction aux groupes de pression minoritaires qui veulent imposer leur censure au nom de leur « sensibilité » blessée. Le dernier en date, créé tout récemment, c’est l’Academic Freedom Alliance, l’Alliance pour la liberté universitaire. Son crédo : « Une attaque contre la liberté académique, où que ce soit, est une attaque contre la liberté académique partout. »
Les membres de l’Academic Freedom Alliance (AFA) affirment venir de tous les horizons politiques. Et s’engager « à défendre la liberté de pensée et d’expression des membres du corps enseignant dans leur travail de chercheurs et d’écrivains, ainsi que dans leur vie de citoyens ; leur liberté de concevoir des cours et de les dispenser en faisant preuve d’un jugement pédagogique raisonnable ; et leur droit de ne pas être soumis à des tests, des affirmations et des serments idéologiques. »
Il y a là aussi un aspect syndical, somme toute assez classique. L’AFA cherche à contrecarrer les pressions exercées sur les employeurs, par exemple par des groupes d’étudiants, afin que ceux-ci prennent des mesures contre les universitaires dont ils désapprouvent les opinions, les déclarations ou les enseignements. « Nous nous opposons à de telles pressions de la part du gouvernement, des responsables des collèges ou des universités, et des individus ou des groupes, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de ces institutions. »
Mais, je vous le disais, l’AFA n’est pas la seule organisation syndicale de défense de la liberté d’expression. En fait, cela fait presque une génération que le phénomène prend de la consistance, à mesure sans doute que les pressions montent. L’un des plus anciens de ces forums s’appelle The Fire, autrement Le Feu, mais c’est en fait l’acronyme de la Fondation pour les droits individuels dans l’éducation.
Elle a vu le jour dès 1998 en Pennsylvanie, et cherche à « défendre les droits individuels des étudiants et des membres du corps enseignant dans les collèges et les universités d’Amérique. Ces droits comprennent la liberté d’expression, la liberté d’association, le respect des procédures, l’égalité juridique, la liberté religieuse et le caractère sacré de la conscience – les qualités essentielles de la liberté. » À noter que, dans la conception américaine, la liberté religieuse sur les campus s’avère une composante fondamentale de la liberté universitaire, ce qui ne coïncide pas tout à fait avec la conception française.
Plus récemment, Heterodox Academy a publié son rapport annuel sur la liberté d’expression dans les universités. Cette organisation met l’accent sur le soutien, y compris sous forme de bourse d’études, à des projets de recherche qui ne pourraient pas trouver leur financement parce que jugés « conservateurs », par exemple. Un autre organisme, Counterweight, veut carrément « offrir un refuge aux blessés des guerres culturelles ». Il se présente comme une communauté organique, une fédération de réseaux de parents, de profs, de psychologues, de travailleurs sociaux ou encore d’employés d’institutions culturelles, universitaires ou artistiques qui cherchent des moyens concrets de protéger leurs professions et de se soutenir mutuellement. Counterweight propose même des modèles de lettres à adresser en cas de nécessité à son employeur. Les Américains, on le voit, n’ont perdu ni le sens critique ni le sens pratique ! Ni celui de la guérilla juridique. Ni celui, dira-t-on peut-être, du bon vieux business.





